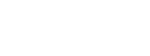Sommaire
1. Introduction
La thérapie des schémas (Schema Therapy), développée par Jeffrey Young dans les années 1990, est une approche psychothérapeutique intégrative initialement conçue pour traiter les patients qui répondaient peu à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) traditionnelle (Young, 1990). Elle combine des éléments de la thérapie cognitive-comportementale, de la théorie de l’attachement, de la Gestalt et de la psychanalyse. Elle se concentre sur les schémas précoces inadaptés (Early Maladaptive Schemas) qui se forment durant l’enfance et l’adolescence.
Elle vise particulièrement les troubles de la personnalité et les pathologies chroniques, en travaillant non seulement sur les cognitions actuelles mais aussi sur les schémas précoces inadaptés profondément enracinés (Young et al., 2003). La thérapie des schémas peut être comprise comme une évolution des TCC : elle conserve leurs outils de restructuration cognitive et de modification comportementale, mais ajoute une dimension émotionnelle et relationnelle.
2. Les concepts fondamentaux
a) Schémas précoces inadaptés (SPI)
Les SPI sont des modèles de pensée et d’émotion formés dans l’enfance, lorsque les besoins fondamentaux (sécurité, attachement, autonomie, expression émotionnelle) ne sont pas satisfaits. Ces schémas deviennent des filtres qui influencent la perception et le comportement à l’âge adulte (Young et al., 2003).
Alors que la TCC classique se concentre sur les croyances actuelles, la thérapie des schémas remonte à leur origine développementale.
b) Modes et stratégies de coping
Un autre apport de la thérapie des schémas est le concept de modes : états émotionnels transitoires activés par des schémas. Le patient peut alors réagir par soumission, évitement ou contre-attaque (Young, Klosko & Weishaar, 2003).
Ces mécanismes complètent les distorsions cognitives étudiées en TCC, en offrant une lecture plus dynamique et émotionnelle des comportements.
3. En quoi diffère-t-elle de la TCC classique ?
La TCC traditionnelle (Beck, 1976) se focalise sur l’identification des pensées automatiques et la restructuration cognitive. Elle a prouvé son efficacité pour des troubles ciblés comme la dépression ou l’anxiété (Hofmann et al., 2012).
La thérapie des schémas conserve cette base, mais :
Elle va au-delà de la cognition consciente, en travaillant sur les émotions profondes liées à l’attachement (Young et al., 2003).
Elle introduit des techniques expérientielles (imagerie mentale, dialogues « de chaises ») absentes de la TCC classique.
Elle intègre la notion de “limited reparenting” : le thérapeute agit comme une figure réparatrice, ce qui dépasse le cadre cognitif habituel (Arntz & van Genderen, 2009).
En ce sens, on peut dire que la thérapie des schémas est une TCC de troisième génération.
4. Déroulement d’une thérapie des schémas
a) Phase d’évaluation
Comme en TCC, le processus commence par une évaluation structurée : questionnaires, entretiens et identification des schémas dominants (Young Schema Questionnaire). Mais ici, l’objectif est plus large : cartographier les schémas, modes et stratégies de coping (Young et al., 2003). Le traitement associe trois niveaux : cognitif, comportemental et expérientiel, pour restructurer les croyances et favoriser la réparation émotionnelle (Young et al., 2003).
b) Phase de traitement
La thérapie combine trois axes (Arntz & van Genderen, 2009) :
Cognitif : restructuration des croyances, comme en TCC.
Expérientiel et relationnel : imagerie, dialogues, reparenting.
Comportemental : exposition, activation, entraînement aux compétences, hérités directement de la TCC.
Techniques cognitives
- Dialogues socratiques pour remettre en question les croyances
- Cartes mémos avec arguments contre le schéma
- Journaux de pensées pour repérer l’activation des schémas
- Continuum cognitif pour nuancer les pensées dichotomiques
Techniques expérientielles (particulièrement importantes)
Imagerie mentale rescénarisée :
- Le patient revisite une scène traumatique de l’enfance
- Le thérapeute guide la rescénarisation où les besoins sont satisfaits
- Le « mode adulte sain » du patient intervient pour protéger « l’enfant vulnérable »
- Durée : 20-45 minutes par exercice
Dialogues de chaises :
- Différentes chaises représentent différents « modes » (parent critique, enfant vulnérable, adulte sain)
- Le patient dialogue entre ces parties de lui-même
- Le thérapeute peut jouer certains rôles
Techniques comportementales
- Exercices de rupture de pattern : agir à l’opposé du schéma
- Exposition graduée aux situations autrefois évitées
- Pratique des nouveaux comportements (affirmation de soi, expression émotionnelle)
- Cartes de rappel pour les situations à risque
La relation thérapeutique comme outil (reparentage limité)
La thérapie des schémas partage des points communs avec l’ACT (Hayes et al., 2006) et la pleine conscience intégrée en TCC, mais elle se distingue par son approche réparatrice des blessures émotionnelles (Arntz, 2012). Le thérapeute adopte un style relationnel chaleureux et validant pour compenser partiellement les carences affectives :
-
- Validation empathique des émotions
- Encouragements et félicitations appropriés
- Autorisation d’exprimer des besoins
- Limites claires mais bienveillantes
c) Phase de consolidation
La dernière étape renforce les schémas sains et la capacité d’auto-régulation émotionnelle. Cette phase rappelle le travail de prévention des rechutes déjà intégré en TCC, mais en y ajoutant une dimension identitaire et relationnelle.
5. Efficacité clinique
a) Personnalité borderline
La TCC classique obtient des résultats mitigés sur les troubles de personnalité. La thérapie des schémas, en revanche, a montré une efficacité supérieure.
Dans un essai contrôlé randomisé, Giesen-Bloo et al. (2006) rapportent 45 % de rémission chez des patientes borderline après 3 ans de thérapie des schémas, contre 24 % pour la psychothérapie focalisée sur le transfert.
b) Revue systématique
Une méta-analyse (Masley et al., 2012) conclut que la thérapie des schémas obtient des effets moyens à grands pour les troubles de la personnalité, supérieurs aux approches cognitives classiques dans certains cas.
c) Applications étendues
La thérapie des schémas est désormais utilisée pour la dépression résistante, l’anxiété chronique et le PTSD (Bamelis et al., 2014). Ces résultats renforcent son positionnement comme extension de la TCC aux troubles complexes.
6. La thérapie des schémas et les TCC de troisième vague
La thérapie des schémas partage des principes avec d’autres approches récentes :
Comme l’ACT (Acceptance and Commitment Therapy), elle vise la flexibilité psychologique et la tolérance émotionnelle (Hayes et al., 2006).
Comme la pleine conscience intégrée aux TCC, elle favorise la prise de distance avec les pensées, mais elle y ajoute une réparation émotionnelle active (Arntz, 2012).
Ainsi, la thérapie des schémas constitue une passerelle entre la TCC classique et les thérapies de la troisième vague. La TCC (Beck, 1976) se concentre sur l’identification et la modification des croyances dysfonctionnelles.
La thérapie des schémas conserve ces outils, mais ajoute des dimensions émotionnelles et relationnelles, incluant des techniques expérientielles comme l’imagerie et le limited reparenting (Arntz & van Genderen, 2009).
Conclusion
La thérapie des schémas s’appuie sur les fondations solides de la thérapie cognitivo-comportementale, tout en élargissant son champ d’action grâce à une intégration émotionnelle, développementale et relationnelle.
Ses résultats, notamment pour les troubles de la personnalité, en font une approche complémentaire incontournable, particulièrement adaptée aux patients résistants aux TCC standards.
Les 18 schémas précoces inadaptés
Ces schémas sont regroupés en 5 domaines :
1. Séparation et rejet
- Abandon/instabilité
- Méfiance/abus
- Manque affectif
- Imperfection/honte
- Isolement social
2. Manque d’autonomie
- Dépendance/incompétence
- Peur du danger
- Enchevêtrement/soi non développé
- Échec
3. Limites déficientes
- Droits personnels exagérés
- Contrôle de soi/autodiscipline insuffisant
4. Orientation vers les autres
- Assujettissement
- Abnégation
- Recherche d’approbation
5. Vigilance excessive et inhibition
- Négativité/pessimisme
- Inhibition émotionnelle
- Idéaux exigeants/critique excessive
- Punition
Références
- Arntz, A., & van Genderen, H. (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Wiley-Blackwell.
- Arntz, A. (2012). Schema therapy: Advances and innovations. Cognitive and Behavioral Practice, 19(2), 149-153.
- Bamelis, L. L., Evers, S. M., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171(3), 305-322.
- Beck, A. T. (1976). Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press.
- Giesen-Bloo, J., et al. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63(6), 649-658.
- Hayes, S. C., et al. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.
- Hofmann, S. G., et al. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 36(5), 427-440.
- Masley, S. A., et al. (2012). A systematic review of the evidence base for schema therapy. Cognitive Behaviour Therapy, 41(3), 185-202.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner’s Guide. Guilford Press.